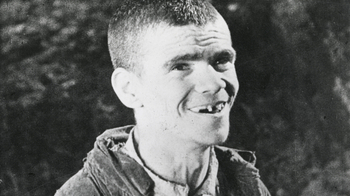Luis Buñuel
Du 10 juin au 2 août 2009
L'obsédé en plein jour
Luis Buñuel incarne la subversion, l'insolence, et l'exaltation de la révolte propre au surréalisme. En près d'un demi-siècle, de 1929 (Un chien andalou) à 1977 (Cet obscur objet du désir), il a signé une œuvre majeure de l'histoire du cinéma. Une main d'homme aiguise un rasoir et vérifie son tranchant sur l'ongle du pouce. L'homme sort sur le balcon, regarde la pleine lune et trois nuages effilés. La même main écarquille l'œil d'une femme entre le pouce et l'index. La femme nous fixe avec un léger sourire. Un nuage passe devant la lune ; en très gros plan, le rasoir coupe l'œil de la femme. Aujourd'hui encore, les spectateurs se détournent. Certains crient. Luis Buñuel a commencé comme ça. Le 6 juin 1929, Un chien andalou est présenté au Studio des Ursulines. Examen de passage réussi : le jeune Espagnol et son complice (un certain Salvador Dalí) rejoignent le mouvement surréaliste. L'année d'avant, Georges Bataille a publié Histoire de l'œil. C'était dans l'air.
Trente-huit ans plus tard, Luis Buñuel tourne la dernière séquence de son dernier film dans l'un de ces passages parisiens chers à Louis Aragon et Walter Benjamin. Assise dans une vitrine, une femme reprise un linge taché de sang. Jean-Claude Carrière écrit dans sa préface aux Entretiens avec Max Aub : « Il tenait beaucoup à cette image, mais sans jamais dire pourquoi. Il la retourna même, pour l'améliorer, deux semaines après la fin du tournage. Il s'agit véritablement de sa dernière image, comme s'il voulait mystérieusement refermer, cinquante ans plus tard, la première et terrible blessure. Entre les deux, le gouffre, le secret. »
Et quand on sait que la légende familiale veut que le petit Luis ait été conçu à l'hôtel Ronceray, sis sur les Grands Boulevards, au-dessus du passage Jouffroy (celui de l'ultime séquence de Cet obscur..., évidemment), pendant le voyage de noces de ses parents... C'est là que l'Aragonais passe sa première nuit quand il débarque à Paris en janvier 1925. Mais brisons-là, tant Buñuel aurait détesté ces interprétations aussi abusives qu'impudiques. « J'aurais eu honte de penser à cela en faisant le film », répondait-il invariablement quand on lui proposait le début du commencement d'une interprétation.
Un cinéaste obsessionnel
Il n'en reste pas moins que Buñuel fait partie des grands cinéastes ouvertement obsessionnels. On peut affirmer sans exagération que la trilogie de la première partie de sa carrière ( / L'Âge d'or / Terre sans pain), réalisée de 1929 à 1933, contient déjà les 29 films suivants. Surréaliste, Buñuel le restera toute sa vie. Lui si peu bavard le répétait à la moindre occasion. Cette fidélité têtue à la grande affaire de sa jeunesse parisienne fait de lui l'unique cinéaste surréaliste, le seul à avoir compris le cocktail explosif entre la puissance émancipatrice du rêve et l'objectivité d'enregistrement propre au cinéma.
Dès ses deux premiers films, il est un cinéaste de la netteté et non du flou artistique. C'est l'exagération proprement surréelle qui révèle un état des lieux. Prenons un exemple. N'est-il pas vrai que la vie en société nous empêche de nous accoupler à toute heure et n'importe où ? Ces choses-là ne se font pas chez les êtres civilisés. Alors il suffira d'inventer le couple au désir inextinguible de L'Âge d'or, qui copule dans la boue pendant que l'on fonde la ville de Rome, un couple que l'on sépare sans cesse mais qui se reforme toujours, et dont la femme finit par s'exclamer : « Quelle joie ! Quelle joie d'avoir assassiné nos enfants ! » Tant il est vrai que les enfants sont rarement le facteur le plus épanouissant de la sexualité de leurs parents, dit-on.
Nous sommes loin, on le voit, d'une quelconque « écriture automatique » appliquée au cinéma. S'il est vain de vouloir le séparer du mouvement surréaliste, tant ce fut la rencontre la plus féconde de sa vie, Luis Buñuel est d'abord cinéaste, un cinéaste qui invente une nouvelle écriture naturaliste à la lumière du surréalisme. Fatalement, le résultat ne ressemble à rien de connu et obéit à une redoutable logique. Si Un chien andalou a fait sensation, L'Âge d'or fait violemment scandale. Ni les amis aristocrates du vicomte de Noailles qui refusent de lui serrer la main à l'issue de la projection, ni les ligues d'extrême droite qui détruisent le hall du Studio 28 ne s'y trompent ; eux voient bien qu'ils ne sont pas en présence d'un aimable et fumeux « film d'artiste » mais d'un véritable brûlot qui cherche à saper tous les fondements de l'ordre établi. Avec L'Âge d'or, le surréalisme est vraiment au service de la révolution. Buñuel va le payer très cher. Sa mise entre parenthèses durera vingt ans, jusqu'au triomphe de Los Olvidados au Festival de Cannes de 1951. Beaucoup le croyaient mort.
« Terre sans pain » : l'un des sommets de son œuvre
Après « l'affaire de L'Âge d'or », Buñuel est grillé partout et même un mécène aussi compréhensif que le vicomte de Noailles ne peut plus rien faire pour lui. « Dois-je penser que pour avoir fait L'Âge d'or, je ne dois plus jamais faire de cinéma ? », lui écrit Buñuel. C'est l'impasse. C'est grâce à la générosité de son ami Ramón Acín et à une caméra prêtée par Yves Allégret qu'il peut tourner Terre sans pain (Las Hurdes) en 1933. C'est un sommet de l'œuvre et le seul documentaire tourné par Buñuel. Face à une réalité pouilleuse et pathogène, il en rajoute au lieu de faire assaut de sobriété, et c'est bien le cinéaste surréaliste qui se défie soudain du naturalisme et fait rimer ces images de la misère la plus noire avec une symphonie de Brahms et un commentaire d'un lyrisme navré et farceur. À la fois parodie d'un documentaire bien-pensant destiné à l'édification des foules et manifeste artistique (« Puisque la réalité est là, il reste à la manipuler »), Terre sans pain contient en une séquence la synthèse de l'attitude de Buñuel face au pur enregistrement du réel. Dans la séquence dite du « coup de pistolet », le commentaire nous annonce qu'il arrive que même les chèvres tombent des reliefs tourmentés des Hurdes, rajoutant ainsi à la détresse économique de ses habitants. Et justement, comme un fait exprès, une chèvre tombe et se fracasse sur les rochers. Mais à gauche de l'image, bord-cadre, on distingue nettement la fumée d'une arme à feu. Buñuel a descendu la chèvre ; il l'a payée ; il l'a filmée et il a soigneusement laissé dans l'image la preuve évidente de sa fausseté. « Le surréalisme, c'est une morale », avait-il coutume de dire.
Quand la guerre civile éclate, il se met immédiatement au service de la République et convoie des fonds entre Madrid et la France avant d'être envoyé en poste à Paris, chargé des questions de propagande. À ce titre, il contrôle le montage et réunit le matériel du film Espagne 37, à la gloire de l'Espagne républicaine. Lâché de toutes parts, le gouvernement espagnol estime qu'un peu de propagande hollywoodienne ne serait pas inutile pour sensibiliser le monde à sa juste cause. Buñuel, qui sent que les choses vont mal tourner, se fait mandater comme conseiller historique. Après avoir tapé le fidèle vicomte de Noailles de 425 dollars pour emmener sa petite famille avec lui, il s'embarque pour l'Amérique en septembre 1938. À Los Angeles, il apprend la défaite républicaine et se retrouve rapidement sans un sou. Il est sauvé par sa rencontre avec Iris Barry et son mari John Abbott, respectivement responsable de la Cinémathèque et vice-directeur du MoMA de New York, qui l'embauchent pour coordonner des films documentaires financés par la Fondation Rockfeller à destination de l'Amérique latine. Ses vieux amis surréalistes ne tardent pas à affluer. Il retrouve Breton, Duchamp, Ernst et Tanguy. Dalí a suivi le mouvement et La Vie secrète de Salvador Dalí paraît en 1942. Devenu « Avida Dollars », il y règle ses comptes avec Buñuel et lui impute l'entière responsabilité de L'Âge d'or, film marxiste et sacrilège. Si le FBI avait sans doute déjà un œil sur ce réfugié espagnol reçu dans tous les milieux communisants de New York, les révélations de Dalí mettent le feu aux poudres. Une campagne de presse oblige Buñuel à démissionner de son poste au Musée d'art moderne.
La période mexicaine
Buñuel sait qu'il est trop atypique pour espérer faire carrière dans les studios et qu'en Europe, tout le monde l'a oublié. L'avenir semble irrémédiablement bouché et, en désespoir de cause, il s'apprête à devenir citoyen américain, un citoyen au chômage. C'est alors que le Hasard, le seul dieu surréaliste, intervient sous les traits de Denise Tual. Veuve de Pierre Batcheff (l'acteur d'Un chien andalou), elle est envoyée aux États-Unis par Gallimard. L'honorable maison d'édition compte redorer son blason, terni par les ambiguïtés de l'Occupation, en battant le rappel des cinéastes exilés. Denise Tual est chargée de leur proposer des adaptations des œuvres dont Gallimard détient les droits. « Lors d'un dîner chez René Clair, elle me dit qu'elle avait les droits pour produire La Maison de Bernarda Alba de García Lorca. Elle voulait tourner le film en France et que j'en sois le réalisateur. » Mais Tual veut d'abord aller au Mexique pour rencontrer le producteur Oscar Dancigers et l'intéresser au projet. Buñuel l'y accompagne. De Mexico, il prend la précaution de joindre le frère de García Lorca, qui l'informe qu'il a une meilleure proposition pour la pièce. Buñuel n'insiste pas mais sa rencontre avec Dancigers – qu'il connaissait déjà de Paris, où Jacques Prévert le lui avait présenté – est décisive dans son installation au Mexique.
En novembre 1946, il commence le tournage de son premier film mexicain : Gran casino. Mais le sort s'acharne, le film est un bide. Le déclic va encore venir de Dancigers qui l'engage pour mettre en scène une petite comédie avec Fernando Soler, célèbre acteur mexicain, Le Grand noceur. Cette fois, le film est un succès public. Et c'est encore Dancigers qui lui souffle l'idée de faire un film sur les enfants misérables de Mexico. Ce sera Los Olvidados, le film du grand retour. Vingt ans après.
Buñuel tournera vingt films au Mexique, avant de redevenir définitivement un cinéaste français avec le triomphe commercial de Belle de jour en 1967. Mais il continuera de vivre à Mexico, ne se déplaçant à Paris ou Tolède (Tristana, 1970) que pour les tournages. Au Mexique, il s'adapte facilement aux codes du cinéma populaire local et devient enfin un cinéaste professionnel qui enchaîne les films avec une régularité de métronome. Mais sans vouloir faire de la peine aux amis mexicains de Don Luis, qui qualifièrent son cinéma de « décaféiné » quand il repartit tourner en France, force est de constater que les films très mexicains dans leur ambiance (l'amusant El Río y la muerte, 1955, ou le pénible et franco-mexicain La Fièvre monte à El Pao, 1959) sont loin d'être les meilleurs. Alors que Él (1952), La Vie criminelle d'Archibald de la Cruz (1955), Nazarin (1959) ou L'Ange exterminateur (1962) sont autant de chefs-d'œuvres qui pourraient se dérouler n'importe où.
Au Mexique, Buñuel livre son Vertigo avec Él, et préfigure Théorème avec Susana la perverse (1951), mais c'est en Espagne franquiste qu'il retourne – à la surprise générale et consternée – pour accoucher de Viridiana (1961), le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvres et le plus grand film catholique romain de l'histoire du cinéma, à la fois épisode de la Légende dorée et mise en cendres de tous les dogmes. « Le plus Espagnol des Espagnols », pour reprendre l'expression de son ami et producteur Ricardo Muñoz Suay, s'amuse à coller le récit picaresque sur une (vague) réalité mexicaine (La Montée au ciel, 1952, et On a volé un tram, 1954) et s'attaque une première fois à son cher Pérez Galdós avec Nazarin. Et quand il adapte des œuvres immortelles, il va tout naturellement puiser dans la bibliothèque surréaliste avec son Robinson Crusoé (1952) et ses Hauts de Hurlevent (1953). Au-delà de ses nombreux sommets et de ses quelques faiblesses, la période mexicaine peut se lire comme un véritable éloge de la constance. Buñuel poursuit ses quelques idées fixes mais sans avoir l'air d'y toucher, tout en recevant les plus grandes récompenses dans les festivals internationaux. Mais au fond, rien n'a changé : la bourgeoisie est toujours aussi odieuse (L'Ange exterminateur, 1962) et seuls les saints et les fous méritent d'être sauvés. Ce qui tombe bien : ce sont souvent les mêmes.
Deux ultimes joyaux en France
Comme il ne pratique pas le pardon des offenses, Buñuel profite de son premier grand retour en France (Journal d'une femme de chambre, 1964) pour régler quelques vieux comptes avec un certain fascisme local, celui-là même qui avait failli avoir sa peau au moment de L'Âge d'or, mais qui ose invoquer « l'amour fou » quand il s'agit simplement de se soulager avec la petite bonne. La répugnance aussi est intacte. Mais cette colère inentamée se mue en autoportrait au vitriol avec les deux ultimes joyaux que sont Tristana et Cet obscur objet du désir. Dans les deux cas, Fernando Rey prête son élégance de grand d'Espagne à la dernière confession. Don Lope et le pantin de Pierre Louÿs souffrent tous deux le martyre pour avoir tenté de réaliser leur rêve de capture d'une jeunesse. Don Luis, lui, n'a aimé qu'une seule femme, la sienne. D'un côté, le fantasme et sa périlleuse incarnation ; de l'autre, la rétention et la persistance de la rêverie. Mais au fond, cela revient exactement au même, n'est-ce pas ?
Frédéric Bonnaud